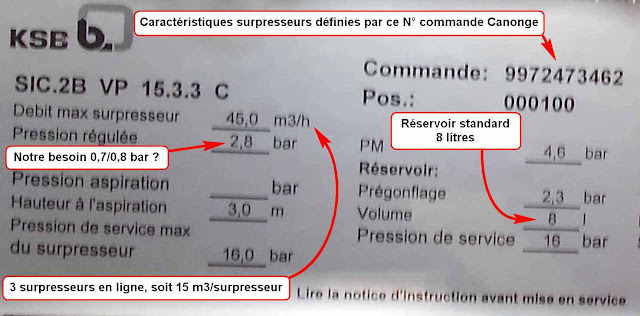|
| Image extraite de l'article source. |
Une relecture de cet article du Monde Diplomatique de décembre 2015 pour les "réformistes".
Cet article n'a pas pris une ride, il montre au passage que le système à points a déjà été utilisé au détriment de la Sécurité Sociale.
Chaque réforme a eu pour but d'éloigner les ouvriers de la gestion de la Sécu.
Source :
https://www.monde-diplomatique.fr/2015/12/FRIOT/54395
Copier-coller de l'article ci-dessous. En allant à la source indiquée ci-dessus, possibilité d'entendre la lecture de l'article.
Une autre histoire de la Sécurité sociale
Depuis sa création en 1945, le régime général de la Sécurité sociale subit
le feu des « réformateurs » de tout poil.
Comment expliquer cet acharnement contre un système que l’on réduit souvent à
une simple couverture des risques de la vie ? C’est qu’au-delà de
l’assurance sociale, les pionniers de la « Sécu » forgeaient un outil
d’émancipation du salariat géré par les travailleurs.
par Bernard Friot &
Christine Jakse
Jean Crotti. – « Motor,
Laboratory of Ideas » (Moteur, laboratoire d’idées), 1921
Bridgeman Images / Musée d’art moderne
de la ville de paris
Dans son roman Les Lilas de Saint-Lazare, paru en 1951,
l’écrivain Pierre Gamarra met en scène Mme Récompense, gardienne d’un
immeuble parisien. « Porte-moi cette lettre à la petite dame du troisième, et
tu auras une récompense »,
dit-elle souvent aux gamins, qui raffolent de ses bonbons. La politique, la
lutte des classes, ça n’est pas son affaire.
Pourtant, en ce jour de
février 1951, elle se joint au formidable cortège qui, sous une pluie battante,
rend un dernier hommage à Ambroise Croizat.
Le peuple de Paris s’est reconnu dans celui qui a mis
en œuvre la Sécurité sociale… et qui, depuis, a disparu de la photographie.
Ouvrier d’usine à 13 ans, militant syndical et communiste, Croizat est nommé
en 1928 secrétaire de la fédération des métaux de la Confédération générale du travail
unitaire (CGTU) et négocie en juin 1936 les accords de Matignon. Quel
danger présente son action en tant que ministre du travail et de la sécurité
sociale, du 21 novembre 1945 au 4 mai 1947, pour que l’histoire
officielle ait décidé de l’ignorer ?
La réponse tient en quelques mots : la mise en
place d’un régime général de couverture sociale qui non seulement mutualise une
part importante de la valeur produite par le travail, mais qui en confie aussi
la gestion aux travailleurs eux-mêmes. Croizat n’invente pas la sécurité
sociale, dont les éléments existent déjà ; il rassemble en une seule caisse toutes les formes
antérieures d’assurance sociale et finance l’ensemble par une cotisation
interprofessionnelle à taux unique.
Les allocations familiales, l’assurance-maladie, les
retraites et la couverture des accidents du travail du régime général ont ceci
de renversant que la collecte des cotisations ne dépend ni de l’Etat ni du
patronat, mais d’une caisse gérée par des représentants syndicaux. La puissance
du régime général est redoutable : selon l’estimation de l’Assemblée
consultative provisoire en août 1945 (1), il socialise dès le départ le tiers de la masse totale des salaires. Ce
système unique sera effectif de 1946 jusqu’au milieu des années 1960.
Entre-temps, il aura fait l’objet d’un travail de sape systématique.
Pour l’histoire officielle, tout paraît simple.
L’affaiblissement de la droite et des patrons, les cinq millions d’adhérents de
la CGT, le « plan
complet de sécurité sociale »
prévu par le Conseil national de la Résistance et l’ordonnance du
4 octobre 1945 qui l’institue auraient ouvert un boulevard aux architectes
du régime général. C’est une fable. La mise en œuvre concrète s’avère
herculéenne. Avec Pierre Laroque, directeur de la sécurité sociale au
ministère, Croizat supervise l’installation du nouveau système en lieu et place
du méli-mélo préexistant : un mille-feuille de couvertures par profession,
par branche, par catégorie de salariés, par type de risque, auxquelles
s’ajoutent les mutuelles et les caisses syndicales et patronales (2). L’unification repose sur les seuls militants de la CGT, la Confédération
française des travailleurs chrétiens (CFTC) s’étant déclarée hostile à la
caisse unique. Les crocs-en-jambe ne manquent pas. Quand les militants
dénichent un local vide pour héberger une nouvelle caisse, il arrive qu’une
administration le préempte (3).
Des résistances inouïes
Pourtant, fin août 1946, les hussards rouges ont mis
sur pied 123 caisses primaires de sécurité sociale et 113 caisses
d’allocations familiales (CAF). Leurs administrateurs, d’abord désignés par le
syndicat, seront bientôt élus par les salariés. Parallèlement se négocie, sous
l’arbitrage de Croizat, une convention collective pour les personnels des deux
instances nationales employeuses : la Fédération nationale des organismes
de sécurité sociale et l’Union nationale des caisses d’allocations familiales,
ce qui permettra de reclasser plus de 70 000 agents issus des
anciennes caisses.
Pourquoi cette séparation entre caisses primaires et
CAF, alors que le projet initial prévoyait une caisse unique ? C’est que l’idée
d’un seul organisme concentrant un tel pouvoir aux mains d’ouvriers se heurte à
une résistance inouïe. Les membres de la commission réunie en juin 1945
pour préparer les ordonnances sur la Sécurité sociale ne parviennent pas à se
mettre d’accord. A l’Assemblée consultative provisoire, une majorité obtient qu’on
sépare les allocations familiales des assurances sociales (maladie et
vieillesse) et des accidents du travail. La démocratie sociale en ressort
affaiblie, car les allocations familiales forment alors la composante la plus
puissante du régime (plus de la moitié des prestations), et leurs conseils
d’administration ne comptent qu’une moitié d’élus salariés contre trois quarts
dans les autres caisses.
Au sein même de la CGT, les appréciations divergent.
La direction confédérale pousse à l’extension maximale du régime général. Mais
les logiques professionnelles portées par les cadres, les fonctionnaires et les
branches comme l’énergie, les mines et les chemins de fer résistent. Ces
dissensions pèsent d’autant plus que plane sur la CGT la menace d’une scission.
Celle-ci intervient en 1947, au début de la guerre froide, et donne
naissance à Force ouvrière (FO). Faisant allusion aux « sérieuses
polémiques »
internes, un document confédéral publié en avril 1946 explique qu’en vue
de la « réalisation
de l’unité des assurances ouvrières », « il
convient de ne pas créer de nouvelles cloisons financières entre les cadres et
le personnel d’exécution, ni entre les professions à taux de salaire
relativement élevé et celles dont le taux de salaire ne dépasse pas le minimum
vital (4) ». La direction confédérale sera battue ; l’Association générale des institutions de retraite
des cadres (Agirc) est créée en mars 1947.
Quant aux fonctionnaires, si la confédération obtient
la même année leur intégration dans le régime général pour la maladie, leurs
mutuelles en sont exfiltrées dès 1947 — les mutuelles, rendues
obligatoires à partir de 2016 par le gouvernement actuel, sont un adversaire
majeur du régime général en matière de santé. La création en 1958 de l’Union
nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce
(Unedic), puis, en 1961, d’un régime complémentaire de retraite réclamé
par le patronat allié à FO et à la CFTC, l’Association pour le régime de
retraite complémentaire des salariés (Arrco), s’effectue contre le régime
général. Or la maîtrise de cette institution par les salariés reposait sur le
taux unique de cotisation interprofessionnelle et sur la caisse unique, qui
unifient le salariat et réduisent le pouvoir d’initiative des employeurs.
Promoteur de la division des caisses qui fissure
l’autonomie ouvrière, le patronat s’appuie également sur le gouvernement, qui,
en dernière instance, fixe les taux de cotisation et le montant des
prestations. Une telle prérogative n’allait pas de soi, puisqu’il fut question
en 1945 que le taux de cotisation soit décidé par les salariés eux-mêmes.
Sensibles aux arguments des employeurs, les gouvernements successifs gèlent le
taux de cotisation au régime général durant toute la décennie 1950. Ce
sabotage de l’institution attise le mécontentement des assurés, qui perçoivent
des remboursements très inférieurs à leurs dépenses de santé réelles.
Des campagnes de presse imputent aux gestionnaires
ouvriers les conséquences d’une pénurie organisée par le gouvernement. Par
exemple, ce dernier maintient les pensions à un niveau extrêmement faible en
refusant au régime général la reconstitution de carrière pratiquée à l’Agirc. L’assurance-vieillesse
affiche donc un excédent considérable, que l’Etat ponctionne goulûment. Henri
Raynaud, secrétaire de la CGT chargé du dossier, montre en avril 1950 que
les neuf seizièmes de la cotisation ne sont pas affectés aux pensions, mais
autoritairement versés à la Caisse des dépôts pour couvrir des dépenses
courantes de l’Etat. Leur cumul représente à ce moment 155 milliards de
francs (5), soit plus de 20 %
du produit intérieur brut (PIB).
Depuis la fin de la guerre, l’administration fiscale
rêve de mettre la main sur la collecte des cotisations. En 1945, la CGT avait
réclamé — en vain — un statut mutualiste pour une caisse nationale afin de
garantir sur le long terme le contrôle de l’institution par les intéressés.
Coupant la poire en deux, les ordonnances d’octobre 1945 dotent la caisse
nationale du statut d’établissement public à caractère administratif, tandis
que les caisses locales ressortissent du droit privé. Les relais du ministère
des finances bataillent au cours des années 1950 pour obtenir le transfert
des cotisations (gérées par les travailleurs) vers l’impôt (géré par l’Etat).
Cette offensive fera long feu jusqu’à la création de la contribution sociale
généralisée (CSG), un impôt affecté au régime général institué en 1990 par
le gouvernement de M. Michel Rocard.
Une autre bataille, mobilisant les mêmes acteurs, fait
rage pour restreindre l’emprise de la CGT. Des cinq élections organisées au
sein des caisses primaires entre 1947 et 1962 la confédération sort
majoritaire, recueillant d’abord 60 % des suffrages (puis 50 % après la création de FO), devant la CFTC (20 %), ainsi que
divers acteurs, dont la mutualité (20 %). Le patronat s’attache à évincer cet adversaire
encombrant de la présidence des caisses en apportant systématiquement ses voix
aux candidats de la CFTC, de FO et de la Confédération générale des cadres
(CGC), avant de se heurter au rapprochement entre la CGT et la minorité
progressiste de la CFTC. La centrale chrétienne entame en effet une
déconfessionnalisation qui aboutit en 1964 à la création de la
Confédération française démocratique du travail (CFDT). C’est d’ailleurs
l’élection de présidents de caisse issus de l’unité CGT-CFDT qui précipitera la
reprise en main gouvernementale et patronale de cette expérience d’autonomie
ouvrière.
Au demeurant, l’intervention de l’Etat ne fut jamais
absente. D’abord légère, elle s’accentue au fil des ans : contrôle
financier (1948), mise sous tutelle des caisses déficitaires (1950), création
de l’Inspection générale de la Sécurité sociale (6) (1960), réduction des pouvoirs des conseils et professionnalisation des
dirigeants des caisses (1960). Le coup de grâce est porté en août 1967 par les
ordonnances Jeanneney, qui imposent le paritarisme. Auparavant, les syndicats
élisaient deux fois plus de représentants que le patronat dans les caisses
primaires ; chacun en
désignera désormais un nombre égal. Cette réforme, portée par le Conseil
national du patronat français et par FO — son secrétaire général André Bergeron
revendiquera la copaternité du dispositif —, s’accompagne de la
suppression des élections des conseils, amputant ainsi les administrateurs de
leur légitimité auprès des salariés (7). Le patronat cogérera ainsi la plus symbolique des institutions ouvrières.
Alors, comme par enchantement, l’assiette et le taux de cotisation au régime
général progresseront de nouveau…
Soixante-dix ans plus tard, on saisit mieux
l’acharnement de la sainte alliance réformatrice contre le régime général géré
par les travailleurs et contre ses architectes. Des textes syndicaux publiés à
l’époque ressort la fierté des ouvriers qui prouvent leur capacité à gérer un
budget équivalant à celui de l’Etat. Même appauvri et mutilé de son caractère
autogestionnaire, ce régime a posé les bases d’une toute nouvelle pratique du
salaire, contraire à la pratique capitaliste courante. En 1946, le revenu
salarié d’une famille de trois enfants (la moyenne dans les familles
populaires) est constitué pour plus de la moitié par des allocations
familiales, dont le montant se calcule comme un multiple du salaire de
l’ouvrier non qualifié de la région parisienne.
Le travail parental est ainsi reconnu par du
salaire : on peut être producteur de valeur sans aller sur le marché de
l’emploi. De la même manière, l’assurance-maladie paie le salaire à vie des
soignants et subventionne l’équipement hospitalier, préservant ainsi le domaine
de la santé du chantage à l’emploi et du recours au crédit, deux institutions
vitales pour le capital. Contre les comptes individuels de l’Arrco-Agirc qui
organisent la retraite comme un revenu différé, le régime général instaure le
droit au salaire continué des retraités, eux aussi reconnus comme producteurs
de richesse. Cette dimension subversive de la cotisation reste farouchement
combattue. Une mobilisation non seulement pour sa défense, mais aussi pour sa
généralisation à l’ensemble de la production raviverait le souffle qui fit
sortir Mme Récompense de sa loge et changea profondément la société
d’après-guerre.
Bernard Friot & Christine Jakse
Sociologues, membres de l’association d’éducation populaire Réseau
Salariat.
(1) « Rapport
sur le projet d’organisation de la Sécurité sociale »,
débats de l’Assemblée consultative provisoire, no 68, Journal officiel du 1er août 1945.
(3) CGT,
« La
défense de la Sécurité sociale », rapport présenté par Henri Raynaud, secrétaire de
la CGT, au Comité confédéral national des 14 et 15 janvier 1947.
(7) Michel
Laroque, La Sécurité sociale. Son histoire à travers les textes, 1945-1981,
tome 3, Comité d’histoire de la Sécurité sociale, Paris, 1993.